- PALÉOGÉOGRAPHIE
- PALÉOGÉOGRAPHIEAprès plus d’un siècle de difficultés, liées à l’insuffisance de nos connaissances, la reconstitution des visages successifs de la Terre – objet de la paléogéographie – est aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des sciences de la Terre. Pour reconstituer les géographies anciennes dans leur succession au cours de l’histoire de la Terre, nous disposons aujourd’hui non seulement des données de la géologie classique de terrain mais aussi de celles qui ont été fournies par les nouvelles branches de la géologie. Il faut citer d’abord la géophysique et la géochimie qui ont permis de comprendre les problèmes de tectonique globale et de pétrogenèse, car la pétrogenèse est indissociable de la paléogéographie, ne serait-ce que parce que le matériau de la croûte continentale est à opposer au matériau de la croûte océanique et du manteau supérieur. Quant à la tectonique globale, après un demi-siècle de tâtonnements (la théorie de la dérive continentale remonte à 1914, sa confirmation au milieu des années 1960), elle tient aujourd’hui la première place car elle se fonde sur des données quantitatives: elles lui sont fournies, d’une part, par le paléomagnétisme, qui permet d’évaluer le déplacement des continents par rapport aux pôles; et, d’autre part, par la géologie marine, qui a découvert l’expansion des fonds océaniques, ou sea-floor spreading (cf. DORSALES OCÉANIQUES, TECTONIQUE DES PLAQUES). C’est alors qu’il devient possible, pour les reconstitutions paléogéographiques, d’utiliser des contours différents de ceux qui résultent des projections mises au point par la géographie actuelle (Mercator, etc.). Des tracés composés par ordinateur ont été effectués avec encore certaines marges d’erreur au moins pour les terrains antérieurs au Trias. Certes, des hypothèses demeurent encore, qu’il faudra vérifier ou remplacer, mais la paléogéographie a bénéficié, d’autre part, du développement de la paléoécologie. Il est lié aux progrès de l’écologie actuelle, confrontés avec les enseignements de la paléontologie (étude des fossiles), de la sédimentologie (étude des roches sédimentaires) et de la paléoclimatologie permettant de reconstituer les paléoenvironnements en tenant compte des variations géochimiques et climatiques (problème de l’uniformitarisme). Enrichie de toutes ces approches, la paléogéographie est ainsi devenue la science de notre monde en devenir.1. Les grandes dates1830 – L’Anglais Charles Lyell énonce les règles de l’uniformitarisme , qui ont permis d’appliquer souvent aux phénomènes anciens les observations faites dans la nature actuelle.1859 – L’Anglais Charles Darwin développe l’hypothèse transformiste et fonde la théorie de l’évolution .1859 – L’Américain James Hall découvre que la chaîne appalachienne s’est formée à partir d’une série sédimentaire extrêmement épaisse, déposée dans une fosse allongée, le géosynclinal .1881 -1901 – L’Autrichien Edouard Suess étudie l’ensemble des connaissances sur l’«histoire de la Terre». Il définit le continent de Gondwana comme une unité ayant réuni l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Arabie, Madagascar, l’Inde, l’Australie (on y ajoutera plus tard l’Antarctide), aujourd’hui bien séparés. Certains de ses arguments sont d’ordres géologiques et tectoniques, d’autres sont biologiques (la flore permocarbonifère à Glossopteris ).1903 – Le Français Émile Haug propose des paléogéographies fondées sur l’opposition entre aires continentales stables et géosynclinaux où germent les futures chaînes de montagnes.1906 – Le Français Albert de Lapparent tente de reconstituer, d’après la stratigraphie, la paléogéographie de l’Europe.1915 – L’Allemand Alfred Wegener expose la théorie de la dérive des continents et l’existence d’une Pangée préalable à la dislocation de ceux-ci. Accueillie avec enthousiasme par les géologues d’Afrique du Sud et du Brésil, cette théorie se heurte au manque de mesures géophysiques.1922 – Le Suisse Émile Argand propose une tectonique de l’Asie reposant sur la dérive continentale et les collisions entre continents qu’elle entraîne.1932 – L’Américain C. Schuchert propose une série de cartes paléogéographiques de l’Amérique du Nord.1932 – L’Américain Bailey Willis expose une théorie des ponts continentaux fondée sur l’exemple actuel de l’isthme de Panamá pour expliquer les relations anciennes entre les continents aujourd’hui séparés.1952 – Indépendamment l’un de l’autre, le Soviétique Strakhov et les Français H. et G. Termier ont publié des séries de cartes paléogéographiques mondiales; ces cartes seront utilisées par Egyed en 1956 pour étayer sa théorie de l’expansion terrestre .1954 – L’équipe de Lamont Observatory, sous la direction de l’Américain Ewing, entreprend de dresser la carte des fonds océaniques, y compris la nature de la croûte, qui les forme.L’Américain Benioff découvre que, sur le pourtour du Pacifique, de grandes failles inverses s’enfoncent, depuis les fosses océaniques, à une profondeur allant jusqu’à 700 kilomètres sous les continents (plans de Wadati-Benioff, ou plans transcurrents).À partir de 1956 – L’école anglaise de Newcastle-upon-Tyne (Blackett, S. K. Runcorn, Creer, Nairn, Irwing et, ultérieurement, Tarling, Briden) découvre l’application du paléomagnétisme au calcul de l’emplacement relatif des pôles et des continents. Ils en concluent à la réalité des déplacements continentaux.1958 – L’Australien S. W. Carey suggère une approche tectonique de la dérive continentale faisant appel à une expansion de la Terre depuis le Crétacé. Il introduit diverses notions liées aux angles de rotation (sphénochasmes).1961 – Raff et Mason cartographient les anomalies magnétiques au large de la côte occidentale de l’Amérique du Nord.1961 – R. S. Dietz propose, pour ces bandes d’anomalies magnétiques successives inversées qui forment ainsi les fonds océaniques, le terme de sea-floor spreading (expansion des fonds océaniques). Il en tirera des conclusions paléogéographiques ultérieurement.1967 – McKenzie et Parker introduisent le terme de plaques pour les calottes crustales qui sont déplacées par la dérive continentale.1967 – Le terme tectonique des plaques est introduit par McKenzie et aussi par F. J. Vine et Hess.1969 – Pour McKenzie et Morgan, les déplacements continentaux se font à partir de jonctions triples entre zones séismo-volcaniques, c’est-à-dire des rifts .Il est bien établi maintenant que les fonds océaniques comme ceux de l’Atlantique, de l’océan Indien, du Pacifique, voire celui des Afars, se forment par expansion de part et d’autre d’une crête dorsale continue atteignant 60 000 km de long, et depuis plus de 80 millions d’années.En fait, la théorie de la tectonique des plaques renferme une partie hypothétique: l’expansion du fond océanique serait exactement compensée par la subduction , c’est-à-dire l’enfoncement, la disparition de la croûte océanique dans les profondeurs du manteau terrestre au niveau des plans de Wadati-Benioff. Mais ce processus (cf. LITHOSPHÈRE, SUBDUCTION) ne peut s’être produit, comme on le verra plus loin, pendant la période antécambrienne de l’histoire de la Terre qui précède 1 milliard d’années. Or, l’un des résultats des déplacements continentaux étant le plissement des chaînes de montagnes (cf. CHAÎNES DE MONTAGNES - Typologie), on s’explique mal comment il s’en est produit pendant tout l’Antécambrien!L’hypothèse de l’expansion de la Terre ne nécessite pas une telle compensation. Proposée entre autres par le Hongrois Egyed et l’Australien Carey, utilisée pour reconstituer une Terre antécambrienne par Dearnley (1965), reprise dans les années 1980, une telle hypothèse se heurte au fait qu’elle n’a pas reçu de confirmation par mesures. En outre, les géologues qui l’ont adoptée ne sont pas encore d’accord sur l’âge de départ du phénomène: dès le début de l’histoire de la Terre (Dearnley), Trias (Owen, 1975), Crétacé (Carey). On doit noter cependant que l’étude de la surface des planètes telluriques et de certains satellites des planètes géantes souligne l’importance des structures d’expansion (et aussi celles des bombardements météoritiques et du volcanisme qui augmentent le volume de la Terre solide).2. Paléogéographie et tectonique globaleÀ l’Archéen, entre 4 et 2 milliards d’années, les plissements constituaient, d’après les reconstitutions proposées par B. Choubert (1935) et R. Dearnley (1965), un faisceau de chaînes flexueuses joignant pratiquement les deux pôles actuels sur une Pangée (fig. 1) continentale couvrant, selon Dearnley, l’ensemble d’un globe bien plus petit qu’il n’est aujourd’hui: ce modèle est celui de la chélogenèse du lac Supérieur . En des zones sinueuses inondées se déposaient des minerais de fer rubanés, non altérés par une atmosphère oxydante mais accompagnés par de la silice. On y trouve les premières traces d’êtres vivants, tous Protocaryotes (Bactéries et Algues Bleues) qui élaborèrent lentement l’oxygène libre de l’atmosphère. Une première fragmentation de la Pangée a eu lieu vers 漣 1750 millions d’années, lors de la révolution hudsonienne . Elle donne deux supercontinents, la Laurasie (Amérique du Nord, Europe, Asie) et le Gondwana (Amérique du Sud, Afrique, Australie, Antarctide); de surfaces sensiblement égales, ils sont séparés par une zone de fractures, la Téthys. Il semble qu’existaient déjà les ébauches des océans Pacifique et Arctique. De ce dernier partaient aussi des indentations de type océanique:1) le Verkhoïansk qui sera fermé au Jurassique supérieur par une chaîne Nord-Sud unissant à l’Asie la Sibérie orientale (laquelle appartenait jusque-là à l’ensemble Alaska-Laurentia);2) le Iapetus (ou Protoatlantique) qui, allant de la région scandinave et calédonienne (y compris l’Est groenlandais) aux Appalaches, se terminait en Amérique centrale et au niveau des Andes (golfe du Jujuy);3) le Belt (emplacement des montagnes Rocheuses et d’un bras de mer de l’Alberta, au Dévonien, de Sundance, au Jurassique);4) l’Oural (suturé par une chaîne à l’Artinskien, puis revenant à un bras de mer russe à plusieurs reprises au Jurassique-Crétacé et pendant le Tertiaire).Ce n’est que depuis 1 milliard d’années que les conditions thermodynamiques permettant la subduction postulée par la tectonique des plaques ont été remplies au niveau de la limite entre la lithosphère et le manteau terrestre. Les chaînes de montagnes formées après cette date seraient donc le résultat du mouvement des «plaques» ou plus exactement des calottes rigides composant la lithosphère. Elles s’éloignent les unes des autres à partir des dorsales océaniques, plongeant l’une sous l’autre et se détruisant dans les zones de subduction (cf. DORSALES OCÉANIQUES, SUBDUCTION). Elles s’entrechoquent enfin sous la poussée de l’expansion océanique, donnant lieu à des collisions, lesquelles font s’élever de vastes chaînes de montagnes.Pendant le Paléozoïque, le modèle Pangée a persisté. La Téthys restait une plate-forme terraquée et fracturée en plein milieu de l’ensemble continental et recevait des mers peu profondes distribuant des faunes (fig. 2). Jusqu’au Siluro-Dévonien, le Iapetus avait des caractères océaniques. Ce schéma fut modifié par la surrection des chaînes calédoniennes qui ferma le Iapetus et souda l’Amérique du Nord avec l’Europe et le Nord-Ouest de l’Afrique, en un continent des vieux Grès rouges , lequel demeurera à peu près intact jusqu’à la fin du Paléozoïque, puis deviendra le continent Nord-Atlantique et enfin se fissurera jusqu’au milieu de l’ère tertiaire (province Thuléenne). En même temps, la bordure septentrionale (eurasiatique) de la Téthys subissait une évolution rappelant celle des chaînes antécambriennes: c’est la zone varisque dont l’évolution – accompagnée peut-être de collisions locales – se poursuivra depuis la fin du Dévonien (avec des plissements) jusqu’au Carbonifère et au Permien (avec des soulèvements, des montées granitiques et une importante métallogenèse). La bordure méridionale (gondwanienne) de la Téthys subissait des allées et venues marines, mais peu ou pas de plissements.À la fin du Paléozoïque et au Trias, l’Iapetus étant définitivement fermé, la Téthys est devenue progressivement océanique, les fissures se sont ouvertes au niveau des Alpes, de Chypre, du Taurus, du Zagros et de l’Himalaya (Indus), constituant des zones à fond océanique. Cette tendance qui fut l’une des causes de la séparation de la Laurasie et du Gondwana, trouva un antagoniste lors de l’ouverture de l’océan Atlantique au Jurassique.À l’écartement donnant naissance à l’Atlantique, correspond donc un arrêt de celui de la Téthys. Cependant celle-ci, entrée en coïncidence avec la zone équatoriale, était devenue l’entité biologique de mer chaude, la Mésogée, qu’elle demeurera jusqu’au Miocène. Mais la dislocation du Gondwana a provoqué la redistribution de certains continents (fig. 3). L’Inde péninsulaire, coupée de Madagascar, subit un déplacement vers le nord, lequel se terminera par une série de collisions (Himalaya) avec l’Asie, entre l’Éocène et le Miocène. L’Australie sera isolée à l’Oligocène. Compte tenu d’un mouvement d’ensemble dans le même sens, de l’Afrique vers l’Eurasie, ces déplacements et collisions ont donné naissance aux chaînes alpines.La dislocation du Gondwana se prolonge encore de nos jours après la séparation de l’Arabie par la mer Rouge, depuis le Miocène, s’accompagnant de l’apparition d’un véritable fond océanique dans le triangle des Afars.Autour du Pacifique, des chaînes se sont succédé pendant une partie du Précambrien et des ères suivantes; elles évoluent encore de nos jours: c’est la ceinture circumpacifique , accompagnée de zones de subduction, grandes failles s’enfonçant obliquement (plans de Wadati-Benioff) dans le manteau supérieur, de fosses océaniques profondes [cf. FOSSES OCÉANIQUES] et, superficiellement, d’une guirlande volcanique et sismique.Ils s’accroissent suivant le mécanisme de l’expansion des fonds océaniques, symétriquement par rapport aux dorsales océaniques et selon un rythme variable, mouvements guidés par des décrochements perpendiculaires à ces dernières, les failles transformantes. En bordure des océans Atlantique et Indien, les fragments de plus en plus nombreux de la Laurasie et du Gondwana ne cessent de s’écarter en direction parallèle à l’équateur, tandis que, dans le sens perpendiculaire, le rapprochement des deux ensembles et même leur chevauchement a donné naissance aux chaînes alpines (cf. chaînes ALPINES) et fait disparaître la Téthys dont la place résiduelle fut tenue à partir du Miocène par la Paratéthys , laquelle a laissé aujourd’hui les bassins pannoniques, pontique, aralo-caspien, et par la Méditerranée (depuis 6,6 millions d’années [Messinien]).3. Paléogéographie et pétrogenèseLa croûte continentale résulte d’une évolution métamorphique des sédiments et des laves jusqu’à la migmatisation, l’anatexie et la granitisation. Parmi les plus anciennes des roches crustales, compte la diorite quartzique. Aux plus grandes profondeurs, la lithosphère est formée de granulites (éclogites, charnockites...).La croûte océanique est essentiellement basaltique.Le terme linéament , qui a d’abord signifié un trait topographique observé à l’échelle régionale, est aujourd’hui employé pour désigner une structure crustale majeure. Les grands linéaments, généralement très anciens, qui intéressent l’ensemble de la lithosphère, séparent les unes des autres les plaques tectoniques, mettent en rapport la croûte océanique et/ou la croûte continentale avec le manteau supérieur dont la composition est très voisine de celle de la croûte océanique. Au niveau de ces linéaments apparaissent donc des roches inhabituelles en surface, mises au jour dans ces conjonctures particulières et qui sont les plus profondes dont l’étude ait été permise aux géologues. Il s’agit de péridotites, de gabbros et de divers types ultrabasiques. L’altération de ces roches en présence d’eau donne souvent naissance à des serpentines. Dans le milieu océanique, cette conjoncture pétrogénétique produit une sursaturation de l’eau en silice, favorable à la pullulation de micro-organismes à squelette siliceux, comme les Radiolaires, puis au dépôt de sédiments siliceux (jaspes et radiolarites). Ce complexe pétrogénétique est nommé ophiolite .Les zones ophiolitiques se rencontrent actuellement au niveau des grands rifts océaniques. À l’état fossile, elles soulignent des régions d’intensité orogénique maximale, ainsi que les derniers restes d’océans définitivement suturés . Enfin, on leur attribue le rôle de marqueurs pour les zones de subduction au niveau desquelles la croûte océanique s’est enfoncée sous la croûte continentale. C’est là que l’on voudrait trouver le moteur de la tectonique des plaques, sous la forme des courants de convection dans le manteau; le phénomène serait déclenché par la transformation, sous de très hautes pressions et en l’absence d’eau, du gabbro océanique en éclogite, phénomène limité par les conditions de stabilité de l’éclogite qui n’ont été réalisées que depuis moins de 1 milliard d’années.Autres relations de la pétrogenèse avec la tectonique des plaques, les points chauds issus de panaches du manteau qui représentent des ascendances de courants de convection, au-dessus desquels passe la lithosphère en dérive. Il s’y produit alors de nouveaux linéaments, souvent disposés en carrefour triple (trivium ), dont chacune des branches prend la structure d’un rift. Ces structures qui se forment aussi bien dans les aires continentales que dans les aires océaniques évoluent: on leur doit sans doute toutes les dorsales océaniques, après avortement d’au moins l’une des trois branches. La chaîne volcanique des Hawaii et les autres chaînes de volcans intrapacifiques en constituent des exemples (cf. océan PACIFIQUE). Il en est de même pour les longs alignements de volcanisme continental comme les centres éruptifs oligocènes et miocènes de la Pologne méridionale jusqu’à l’Eifel, ou comme ceux qui accidentent la province Thuléenne des îles Feroe à l’Écosse et au nord-est de l’Irlande. On en connaît d’ailleurs de fossiles, dès le Paléozoïque, tels les «aulacogènes» d’Afrique et de l’Oklahoma.Quoi qu’il en soit, le magma basaltique offre des compositions diverses selon la manière dont il surgit et la nature des roches qu’il traverse et digère (contamination): alcalin et tholéitique dans les crêtes océaniques; calco-alcalin au niveau des bordures continentales; il passe à des carbonatites et à des kimberlites (diamantifères) dans des cheminées d’explosion traversant les continents anciens et provenant d’une profondeur de 100 à 300 km; il accompagne les granites en anneaux au-dessus de certains panaches.4. Paléogéographie et paléoécologiePrincipesLa paléoécologie tente de reconstituer les conditions qui se sont succédé dans les océans et sur les continents depuis l’apparition de la Vie. Le parallélisme de cette science avec l’écologie moderne ne doit pas faire oublier que certaines notions clefs de celle-ci, par exemple celle de biomasse, sont peu utilisables en paléobiologie car impossibles à traduire en chiffres précis quand seuls les squelettes et autres parties dures témoignent de l’occupation des lieux, à l’exclusion de tous les tissus mous, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des gisements. En revanche, les modifications subies par les différents milieux au cours des temps géologiques apportent une dimension nouvelle, diachronique, qui est celle du monde inorganique [cf. TERRE]. Ainsi, dans la paléoécologie, entrent en ligne de compte les changements de composition de l’atmosphère et des océans et, par voie de conséquence, les variations des cycles géochimiques et biochimiques intéressant la biosphère. On peut citer quelques exemples, où de tels cycles ont façonné les supports de la Vie. Ainsi, l’oxygène n’est apparu dans l’atmosphère terrestre que tardivement comme un sous-produit de la photosynthèse qui l’a libéré des oxydes minéraux; ce phénomène est un préalable à la vie animale, énergétiquement fondée sur la respiration; le taux actuel de l’oxygène dans l’atmosphère ne fut atteint qu’à la fin du Dévonien (entre 400 et 360 millions d’années). Des variations dans les cycles géochimiques, liées à l’écologie et au comportement biochimique spécifique des êtres vivants, jouent et ont joué un rôle primordial dans la répartition de l’azote et aussi du soufre.La paléogéographie et la paléoclimatologie fournissent le cadre de la paléoécologie. L’étude des groupes fossiles et des roches sédimentaires les contenant permet d’analyser les facteurs écologiques dans les couches qui les renferment. Toutefois, il y a lieu d’être prudent dans les interprétations: la gangue sédimentaire n’est pas semblable au substrat initial car elle a généralement subi des transformations: cf. DIAGENÈSE) et parce que des modifications ont affecté les constituants chimiques des cadavres d’être vivants, à la suite de la disparition presque totale de la matière organique putrescible et par le remaniement des minéraux formant les squelettes [cf. FOSSILES ET FOSSILISATION]. Il y a toutefois lieu de mentionner que, dans certains niveaux surtout anaérobies et protégés à la fois des actions d’une atmosphère oxygénée et d’une forte température géothermique, on a pu identifier certains acides aminés, des produits de décomposition de la chlorophylle, etc., identifications d’un prix inestimable lorsqu’il s’agit de terrains antécambriens dans lesquels les traces de Vie sont non seulement rarissimes, mais encore souvent contestées.Les ensembles vivants (écosystèmes) doivent être recherchés dans les séries stratigraphiques.Méthodes de la paléoécologieLa fossilisation supprime la plus grande partie des composés organiques et jusqu’à la forme des parties molles, sauf de rares exceptions comme dans le Cambrien de la Burgess Pass (Colombie britannique), le Namurien-Moscovien de Mazon Creek (Montana), le Portlandien de Solnhofen (Bavière). Certains sédiments, tels que les grès, ont souvent été déposés dans des eaux oxygénées et agitées, conditions favorisant la dissolution des tests carbonatés; d’autre part, la dolomitisation des calcaires détruit complètement les contours des fossiles.Les schistes et les calcaires noirs riches en matière organique décomposée et en sulfure de fer, qui dégagent – même après des centaines de millions d’années – une forte odeur de putréfaction, ont mieux conservé les fossiles. Malheureusement, ils correspondent à des dépôts riches en hydrogène sulfuré et impropres à la Vie : les faunes qu’ils ont si bien préservées sont parfois venues d’ailleurs; même si ce n’est pas de très loin, elles n’ont pas vécu exactement là où elles sont mortes. Beaucoup d’ensembles fossiles ne résultent en fait que d’une mise en place posthume, pouvant même comporter plusieurs remaniements successifs échelonnés sur une longue durée (assemblages de thanatocénose).Cependant, les endofaunes vivant au sein du sédiment sableux ou vaseux – ainsi que les faunes et les flores fixées et demeurées attachées sur place – sont retrouvées là où elles ont vécu; elles sont associées très souvent à des traces, qu’il s’agisse de leurs propres terriers ou de pistes à la surface des couches. Leur comparaison avec leurs homologues récents permet les analyses paléoécologiques les plus sûres. Les accumulations de coquilles mortes (lumachelles) peuvent souvent être comparées à des dépôts de plages, dont la signification est davantage liée au niveau d’énergie des vagues qu’à la biologie.L’interprétation de certaines faunes archaïques reste douteuse: ainsi, les Graptolites et certains Bivalves paléozoïques, associés à des traces d’Algues, suggèrent une vie épiplanctonique comme celle des habitants de la mer des Sargasses; c’est une hypothèse à forte probabilité, mais non une certitude. Les restes de biotopes à Sargasses de type récent sont connus dans l’Oligocène des Carpates et de Crimée. Mais on n’a pas encore trouvé d’intermédiaires entre les deux ensembles.Divers groupes ont vu se modifier quelques-uns de leurs caractères écologiques. Les Spongiaires Hexactinellides se sont enfoncés dans les mers profondes ou ont gagné les mers froides. Les Gastéropodes Pleurotomaires, jadis littoraux – et bien d’autres formes, en voie d’extinction peut-être –, ont gagné la zone bathyale. L’application de l’uniformitarisme ne saurait en aucun cas être automatique: la paléoécologie se présente comme un ensemble d’hypothèses qui, à la manière des modèles de la physique, demandent parfois d’être révisées.Un effort considérable a été fait pour quantifier les recherches paléobiologiques. Par exemple, on établit les numérations des diverses espèces pour une niche écologique donnée et l’on essaie de suivre l’évolution d’un tel système dans une région donnée. La représentation par symboles proposée par Hekker a donné de bons résultats et peut s’accompagner de courbes. Les reconstitutions d’organismes fossiles dans le détail de leur physiologie sont aussi rendues plus précises. La base objective de la géologie de terrain (à savoir la cartographie, la stratigraphie et la géologie historique) passe progressivement à des synthèses interprétatives dont l’ensemble, désigné volontiers sous le nom de paléoenvironnement repose en fait sur l’analyse sédimentaire et paléobiologique.Un exemple de ce genre d’étude est le modèle littoral , bordure continent/océan, que l’on peut reconstituer pour des terrains sédimentaires datés depuis plus de 2 milliards d’années dans tous les pays. L’un des principaux indices est fourni par l’incidence sur la sédimentation de la puissance énergétique de la mer dans les divers points du littoral: 1. une zone de haute énergie , où déferlent les vagues, correspondant au principal choc des flux de marées ou de tempête: les sédiments y sont roulés (galets, conglomérats), tandis que les organismes qui peuvent y être solidement accrochés y trouvent l’avantage d’une forte alimentation en oxygène, comme c’est le cas pour les récifs coralliens; 2. vers le continent, en arrière de la première zone, dans l’étage supralittoral , l’eau a perdu de sa violence: il s’installe des lagunes stagnantes et à salinité variable, ce qui élimine le gros des Échinodermes et les Céphalopodes, tandis que les rochers fréquemment exondés sont sculptés par les embruns; le peuplement compte des organismes tolérants aux variations de salinité, de température, d’éclairement, pouvant même accepter des temps d’exondation, mais favorisés par le calme des eaux; de faible énergie également, l’étage infralittoral , qui reçoit des dépôts fins et réguliers, mais où l’eau conserve une salinité normale constante.Les trois zones de ce modèle littoral permettent de situer, d’après leur forme et leur statut écologique moderne, les Algues et les Invertébrés. En corollaire, les organismes implantés dans les zones du modèle littoral enregistrent plus ou moins les rythmes cosmiques, lesquels sont révélés par l’accroissement des squelettes (coquilles et polypiers). Ces rythmes sont divers: circadien (jour/nuit), synodique (lunaire), tidal (marées), saisonnier; le rythme sexuel se superpose à eux. Le déchiffrage de ces rythmes donne quelques indications sur les variations de la durée de l’année terrestre au cours des temps géologiques (400 jours par an au Dévonien, il y a environ 400 millions d’années).Les variations de l’écosystème pélagique ont pu être reconstituées grâce à l’étude du phytoplancton (productivité primaire). Elles expliquent en partie les hauts et les bas subis par les consommateurs (fossiles) au cours des temps géologiques.Histoire de la biosphèreLa biosphère s’est étendue d’abord aux étages infralittoral et tidal (supratidal). Elle n’a gagné que tardivement les mers profondes et les continents. L’étage circalittoral et les parties hautes de la zone bathyale ont été atteints assez tôt, au moins à partir du Lias. En ce qui concerne les mers plus profondes que 2 000 m, on est sûr de leur existence dès le Crétacé; certains biotopes, d’abord littoraux, s’y sont progressivement réfugiés (Pogonophores, Crinoïdes, Hexactinellides...). Tandis que des groupes entiers sont restés fidèles à un seul milieu (Lingules, Limules). D’autres, au contraire, ont étendu leur aire.En paléogéographie, on doit envisager des déplacements de faunes (et de flores) d’un type différent des migrations d’animaux revenant ensuite à leur pays d’origine (Oiseaux, Insectes, Anguilles) en une ou deux générations. Il s’agit de la conquête du terrain, accomplie par de nombreuses générations successives, en des temps d’ordre géologique (unité: le million d’années). Ce sont les prochorèses , extensions de proche en proche d’une aire habitée par l’espèce, provoquées par une pénurie (d’aliments ou d’espace) et par la vacuité réelle, à la suite de changements brutaux, ou potentielle lors d’une occupation précaire des lieux adéquats. De tels gains de territoire, qui peuvent être favorisés par de minimes modifications de climat par exemple, ont été couramment observés à la période historique et mesurés (taux de migration, Kurtèn). À l’échelle des temps géologiques, la durée d’une prochorèse peut avoir été suffisamment longue pour que l’espèce ait notablement évolué. Favorisés par des prochorèses furent les carnivores, pas trop spécialisés, pour lesquels il est vital d’étendre l’aire de chasse. Pour les organismes marins, la possibilité de supporter des variations de salinité (nombreux Arthropodes, Poissons) fut un facteur paléoécologique dominant.L’expansion de la biosphère a profité à trois embranchements d’Invertébrés plus particulièrement: les Mollusques et les Arthropodes y ont trouvé leur épanouissement et, selon des options diverses, ont conquis tous les milieux aquatiques et continentaux; les Échinodernes, en revanche, ont conservé une proportion relative à peu près constante dans les faunes, mais leurs divers modèles se sont beaucoup modifiés (adaptés).La situation des organismes dans les hiérarchies alimentaires n’a guère varié. Les symbioses avec des êtres photosynthétiques simples (Protocaryotes) ont été suivies au cours du début des temps fossilifères par des symbioses plus complexes ajoutant des Eucaryotes aux Protocaryotes. Une production abondante de phytoplancton a précédé l’apparition des animaux marins métazoaires. Le régime «filtreur» microherbivore semble, avec l’aide des symbiotes, pouvoir s’accompagner de l’absorption de matière organique dissoute. Avec les Cnidaires, déjà bien représentés dans la faune édiacarienne (cf. règne ANIMAL), apparut le régime microcarnivore; avec les Vers et les Échinodermes, le régime «sédimenteur». Ils ont précédé de peu des régimes macrophages (Priapulides du Cambrien). Les grands carnivores marins (Céphalopodes, Euryptérides) sont apparus assez tardivement à l’Ordovicien. Si l’on considère les Vertébrés, ils semblent avoir débuté par des filtreurs (Céphalaspides, par exemple), des mangeurs d’Invertébrés et des herbivores avant d’en venir, sur la terre ferme, aux insectivores qui constituent la charnière entre herbivores et carnivores.5. Évolution et paléoenvironnementNous avons vu que la géographie s’est modifiée sans cesse depuis qu’existe la croûte terrestre.Biocénoses archaïquesL’apparition de la Vie sur notre planète remonte, selon l’état actuel de nos connaissances, à 3,4 milliards d’années. À l’Antécambrien, cette vie demeurera restreinte aux Protocaryotes (Bactéries et Algues Bleues) jusqu’à il y a environ 1 milliard d’années. Elle occupe deux biotopes distincts: un benthos tapissant le fond de mattes et fossilisé par les Stromatolites calcaires qu’induisent des Cyanophycées filamenteuses et des Bactéries; et un abondant phytoplancton pélagique. Végétaux d’abord, puis aussi animaux, les Eucaryotes se sont installés dans ces deux types de biotopes, en tirant d’eux une aide considérable sous forme d’environnement et de symbiose (théorie symbiotique de l’origine des Eucaryotes). Cette démarche évolutive aboutit d’abord à des monocellulaires (Flagellés), à des Algues dans les mattes, puis à des Archéates aboutissant à des Spongiaires, lesquels constituent l’une des deux voies réalisant un statut de Métazoaire (pluricellulaires). Des animaux très primitifs comme les Spongiaires et les Échinodermes possèdent des Protocaryotes symbiotes (Cyanobactéries) en grande quantité dans leurs cellules, tandis que les Cnidaires et la plupart des Coelomates ont des symbiotes Eucaryotes (Flagellés). Il y a 680 millions d’années, le biotope pélagique s’est enrichi d’une faune d’animaux métazoaires, nectobentoniques et littoraux, ayant souvent l’aspect de grosses larves: là est l’origine des Cnidaires et des Coelomates.Au Cambrien inférieur apparaissent dans les mattes stromatolitiques des biotopes benthoniques où subsistent des squelettes calcifiés, de très petite taille, ce qui suggère qu’il s’est produit une métamorphose précoce des larves (Mollusques). En outre, la faune spécifique de ces mattes, à savoir les Archéates (Archéocyathes et Spongiaires), se développait essentiellement dans la zone circumpacifique (alors intertropicale) et la Téthys. Les Protocaryotes dominent encore le substrat des deux ensembles. Une biocénose benthonique contemporaine est celle des Pogonophores, aujourd’hui présente dans les profondeurs bathyales et abyssales comme semi-endofaune. Le Cambrien inférieur voit aussi apparaître des biocénoses de Trilobites vivant à la surface de fonds vaseux, dans lesquels ils s’enfonçaient superficiellement. Au sein de cette biocénose, en des niches très localisées, se trouvaient des Échinodermes primitifs dont l’organisation incluse dans une forme de sac allait évoluer vers la fixation ou la liberté et selon une symétrie radiaire et/ou bilatérale. L’abondance des pistes, des traces de repos, des terriers et des indices de fouissement prouve la présence d’une endofaune pléthorique dans nombre de sédiments vaseux et sableux du Cambrien. La célèbre biocénose de la Burgess Pass (montagnes Rocheuses) montre l’existence, il y a 530 millions d’années, d’Invertébrés benthoniques et pélagiques des types les plus variés, associés à des Algues non calcaires.Évolution des biocénoses marinesPendant le Paléozoïque inférieur (Cambrien, Ordovicien), il existe une grande ressemblance entre les terrains de l’Ouest européen, la Nouvelle-Écosse (presqu’île de Georgie qui appartient aujourd’hui à l’Est de l’Amérique du Nord) et le Maroc. Cet ensemble constituait une seule province (peut-être une seule plaque). La Nouvelle-Écosse a été captée au cours des mouvements calédoniens par ses attaches continentales actuelles. Au Cambrien supérieur, les Trilobites appartiennent à des biocénoses diversifiées: sur la rive occidentale du Iapetus, les Olénidés, par exemple, sont associés aux fonds peu aérés, riches en Algues, puis en H2S, qui occupaient alors la province scandinave. D’autre part, après une éclipse durant les périodes moyenne et supérieure du Cambrien, les biotopes récifaux se sont à nouveau développés à l’Ordovicien, dans la zone tropicale alors située dans l’Amérique arctique, la Scandinavie, la Sibérie et l’Australie [cf. ORDOVICIEN]. À la même époque se développent les biocénoses à Ectoproctes, Graptolites et Ptérobranches benthoniques et pélagiques (mers à Sargasses?). Les Céphalopodes prendront alors dans les mers une importance d’autant plus considérable que, redoutables carnivores, ils ont certainement joué un grand rôle dans la destruction de quelques groupes, les Trilobites par exemple. D’autres prédateurs, comme certains Mérostomes et les Euryptérides, se montraient capables de s’adapter à des eaux saumâtres ou même douces. L’Ordovicien représente la période la plus riche du Paléozoïque pour la diversité des microflores et des faunes marines.Les conditions atmosphériques modernes ont dû commencer au Siluronien [cf. GÉDINNIEN] dans les mers, où les biotopes continuaient de se diversifier à partir d’herbiers et de vasières, et sur la terre ferme, peu à peu colonisée par la flore et la faune à partir des rivages et des berges de rivières. Dès le Dévonien inférieur est connue la gamme moderne des spécialisations tidales (animaux capables de conserver l’humidité un certain temps) et infratidales (herbiers, vasières). Les endofaunes situées à des profondeurs de fouissement diverses sont décelables à la même époque (par exemple au Dévonien).Émergence des biocénoses continentalesAvec l’apparition de la couverture végétale, l’aridité des continents a régressé. Des biotopes terrestres se sont diversifiés, fidèlement suivis par l’évolution des Trachéophytes, ou plantes vasculaires (Ptéridophytes et Phanérogames), et des Vertébrés.La biosphère étant de plus en plus continue et variée, on distingue de mieux en mieux, grâce aux peuplements fossiles, les lignes de rivage, et l’on interprète d’autant plus facilement la signification écologique des animaux et des végétaux disparus que ceux-ci se rapprochent de leur représentants actuels. Depuis le Dévonien, les conditions de climat et la composition de l’atmosphère ont été de type moderne.6. PaléobiogéographieSeule la tectonique globale permet d’expliquer certaines répartitions aberrantes d’aujourd’hui. C’est le cas de la distribution amphiatlantique des Vers de terre, dont les divers genres ne sont pas spéciaux chacun à un continent mais se trouvent groupés selon les aires enjambant, parallèlement à l’équateur, l’Atlantique comme s’il n’existait pas.Elle explique aussi comment les animaux et les plantes ont réagi aux changements climatiques et aux transformations territoriales liées à la dérive continentale.Rôle des variations climatiquesL’une des premières découvertes ayant mené à la tectonique globale fut celle du déplacement relatif des continents et des pôles. Les données paléomagnétiques fournissent les positions des pôles magnétiques; les données paléoglaciologiques (moraines et varves) fournissent les positions des pôles climatiques. Des vestiges de calottes glaciaires limitées, vraisemblablement polaires, sont connus dès l’Archéen, vers 1,9 milliard d’années, au Québec (glaciers de Gowganda Cobalt) et au Transvaal. Plus tard on trouve des traces d’une glaciation générale à l’Éocambrien vers 700 millions d’années, avec un maximum sur le continent africain.Grâce aux mesures paléomagnétiques, on situe, à partir du Cambrien et jusqu’à la fin de l’Ordovicien, le pôle magnétique à l’ouest de la côte de l’Afrique occidentale actuelle, au niveau des îles Canaries. À cette époque, on trouve d’ailleurs les empreintes d’un vaste inlandsis couvrant l’Afrique occidentale et aussi une partie de l’est de l’Amérique du Sud, avec un maximum sur l’emplacement de l’Ahaggar.Mais, dès le Siluronien, les marques d’inlandsis se trouvent décalées vers le sud de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, en conséquence d’une première dérive poussant l’Afrique vers la Laurasie, et dont une des répercussions fut la surrection des chaînes calédoniennes et varisques. Décelée par les méthodes paléomagnétiques, cette dérive gondwanienne continuera, avec des à-coups, jusqu’à l’époque actuelle.En règle générale, une seule province faunistique d’ensembles marins, téthysienne au Paléozoïque, mésogéenne du Trias supérieur jusqu’à l’Oligocène, séparait les deux supercontinents. Quand les conditions climatiques s’égalisaient dans les mers jouxtant les ensembles continentaux séparés par une Téthys plutôt étroite, les faunes mondiales, non découpées en provinces, se sont dispersées. C’est ce qui arriva lors des transgressions téthysiennes.Cependant, des climats souvent aussi distincts que sur le globe actuel, ou même qu’au cours des glaciations quaternaires, ont affecté la planète pendant les temps géologiques. La diversification des faunes s’est alors effectuée, et l’on est confronté à des problèmes géologiques dont la réponse est fournie par la tectonique globale. Nous en avons de bons exemples au Carbonifère, entre 320 et 270 millions d’années. L’ensemble gondwanien, alors indivis (Amérique du Sud, Antarctide, Afrique, Madagascar, Arabie, Inde péninsulaire [Dekkan], Australie et Nouvelle-Zélande), subit une période glaciaire donnant naissance à de multiples inlandsis. Lors des rémissions interglaciaires et juste après la dernière poussée glaciaire, les trangressions marines eustatiques venant de la Téthys sur la bordure septentrionale du Gondwana y apportaient une faune appauvrie, comprenant des espèces de mer froide. Cela se produisit dès le Viséen supérieur en Iran et en Afghanistan central, et se généralisa au Gjélien et au Sakmarien, mais hors de l’Iran. Cette faune compte des Brachiopodes: les Productides Taeniothaerus et Stepanoviella , le Spiriféride Tomiopsis et le Bilvalve Eurydesma qui caractérise les phases terminales de ces avancées de mer froide. Cette faune n’est pas moins propre à la mer gondwanienne que ne l’est de nos jours la faune boréale circumarctique à l’ensemble des mers nordiques. On la trouve aussi bien sur la frange septentrionale de l’Inde péninsulaire (aujourd’hui située au nord de l’océan Indien et de l’équateur) que sur le pourtour de l’Australie (aujourd’hui au sud de l’océan Indien et de l’équateur). La disjonction aréographique actuelle ne s’explique que par la translation (depuis le Jurassique supérieur et vers le nord) de l’Inde péninsulaire ayant coupé ses attaches avec Madagascar, l’Afrique, l’Arabie et l’Australie. Le phénomène général se montre encore plus ancien, car si, pendant le Sakmarien, l’Afghanistan central était sous la dépendance de la mer froide gondwanienne, à Eurydesma et sans Fusulines, l’Hindou-Kouch et le Band-i-Turkestan faisaient alors partie du domaine nord-téthysien équatorial de la mer à Fusulines. Mais tout de suite après, le même Afghanistan central recevait la mer à Fusulines avec ses faunes chaudes. Il semble probable que déjà le bloc Aryana comprenait cette région et que l’Iran dérivait vers le nord.On peut dire que, dès le Carbonifère, le pôle Sud était situé à la limite de l’Afrique du Sud et de l’Antarctide.Tout se passe donc comme si deux positions d’équilibre de l’axe des pôles avaient existé au cours des temps géologiques: la première (un pôle arctique/un pôle antarctique) fut celle de l’Archéen, puis des temps postpaléozoïques, voire postcarbonifères (fig. 3); elle entraîne une rotation plus rapide dans la zone moyenne des continents située au niveau de l’équateur. Elle coïncide avec la disjonction continentale selon des océans subméridiens. La seconde position d’équilibre (où l’axe des pôles perce d’un côté l’ensemble continental vers son centre géographique, et de l’autre côté, l’ensemble océanique) est la position cambro-ordovicienne, avec son pôle canarien (fig. 2). La rotation maximale équatoriale coïncide alors avec le pourtour du Pacifique. L’histoire de la translation apparente de ce pôle continental pendant le Paléozoïque supérieur correspond à un déséquilibre entre ces deux positions: on passe de l’une à l’autre avec les conséquences climatiques que cela entraîne pour les calottes glaciaires et pour la zone chaude intertropicale, généralement accompagnée de constructions récifales. Ainsi avons-nous vu qu’à l’Ordovicien supérieur la province récifale américano-arctique était parfaitement corrélative de la position de l’inlandsis africain.Pour cette période antérieure au Mésozoïque, cependant, demeurent des problèmes climatiques non résolus. Par exemple, la répartition au Cambrien inférieur des Archéocyathes, organismes plus primitifs que les Spongiaires et dont la biocénose, associée à des Stromatolites, est de type récifal. À l’époque, le pôle était «canarien», non loin du point de confluence du Iapetus (Protoatlantique) et de la Téthys, ces deux structures étant donc quasi méridiennes. En bonne logique, le Sud marocain, alors soudé aux Canaries par la zone d’Ifni, devait être sous un climat subpolaire, tandis que la Téthys orientale, et elle seule, située en bordure du Pacifique, était sous climat tropical. Or des récifs d’Archéocyathes, à peine moins exubérants que ceux de Sibérie et d’Australie, sont présents dans le Sud marocain. Parmi les hypothèses proposées pour rendre compte de cette apparente anomalie, il semble que l’existence d’une phase mondiale chaude et de courants marins unificateurs soit la plus plausible. On connaît en effet le caractère de régulateur thermique que possèdent les masses d’eau; et le paléogéographe constate que l’ouverture d’un océan et les climats de mousson modifient la zonation normale. En outre, par comparaison avec les Spongiaires des mers actuelles, on peut ajouter que ces organismes vivent à faible profondeur dans les mers froides de l’Antarctique et que des conditions tempérées suffisent certainement à permettre la sécrétion d’un squelette calcaire chez des organismes aussi tolérants.Depuis le Cambrien, le dualisme protoatlantique (Iapetus)-Atlantique/Téthys-mésogée (océan Indien, Méditerranée, etc.) a permis une alternance de transgressions adoucissant les climats à partir de l’Arctique vers les régions téthysiennes, et de transgressions téthysiennes adoucissant et même homogénéisant les climats à partir de la Téthys ou de la Mésogée vers les régions polaires. Cette constatation s’impose même pour les temps où la Téthys était quasi méridienne (au Paléozoïque) avant d’être subéquatoriale. La disparition de l’Atlantique au moment des plissements calédoniens, ou de la Téthys au moment de la formation des chaînes alpines, a supprimé l’un des deux régulateurs thermiques les plus importants et permis l’installation de périodes de sécheresse et l’évaporation (climat semi-aride du continent dévonien des Vieux Grès rouges, assèchement d’une partie de la Méditerranée au Messinien). La suppression d’un régulateur climatique doit être rendue responsable du compartimentage en provinces bioclimatiques.Rôle des dislocations continentalesDepuis 80 millions d’années (Crétacé supérieur), en accord avec la position de l’axe des pôles depuis la fin du Paléozoïque, une nouvelle époque tectonique a commencé. C’est la fracturation des vieux supercontinents et la séparation de plaques tectoniques dont l’écartement a pour conséquences l’ouverture des nouveaux océans de direction méridienne, l’Atlantique, l’océan Indien, le Néopacifique et le Néoarctique, et finalement l’axe mer Rouge-Afars en même temps que des collisions aboutissant, entre autres, aux chaînes alpines.S’en sont suivis de nouveaux problèmes biologiques. En effet, pendant que les continents étaient unis en deux supercontinents, voire une Pangée, les organismes marins n’avaient que de petites distances à parcourir pour migrer, à condition que les climats ainsi que les fonds sur lesquels ils pouvaient vivre le permissent. D’où l’existence de vastes provinces biologiques au Cambrien, à l’Ordovicien, au Silurien, au Dévonien et même au Viséen, surtout pendant les périodes de chaleur universelle que furent les transgressions téthysiennes. La Téthys fut longtemps le grand promoteur de dispersion de faunes, ces dernières se diversifiant surtout lors de périodes de glaciation. En ce qui concerne les faunes continentales, on retrouve à peu près le même phénomène avec des conséquences différentes, telles que le passage d’un supercontinent à l’autre, facilité par les régressions de la Téthys, coïncidant entre autres avec les glaciations. C’est ainsi qu’au Permien, les zones de Reptiles des bassins de la plate-forme russe sont presque identiques à celles de l’Afrique parce qu’un continent eurafricain était issu de l’orogenèse varisque. Pendant le Permo-Trias, étage de transition, l’unité des continents gondwaniens reste prouvée par la répartition du genre Lystrosaurus , lequel a été recueilli en Antarctide, en Afrique du Sud (Karroo), dans l’Inde péninsulaire et dans le Tarim (Sinkiang).Le morcellement du Gondwana a débuté au Trias moyen pour ce qui est de sa bordure septentrionale (téthysienne). Le départ de l’Inde péninsulaire remonte au Crétacé supérieur, tandis que l’ensemble lémurien (Inde-Madagascar) a été séparé de l’Afrique dès le Trias. L’isolement de l’Inde est consommé au Crétacé supérieur, après la disparition des Titanosaures (Dinosauriens Sauropodes); elle portait alors une végétation riche, comparable à celle de l’Afrique du Sud (Araucariées tempérées, Bananiers, Palmiers, Tilleuls, Myrtes, Lauriers et autres plantes tropicales). On y trouve aussi des Amphibiens Anoures leptodactyles. L’Inde accomplit un long voyage qui l’amènera à se souder au Sud de l’Asie. Ce «continent errant», appauvri par son vagabondage sous les climats divers, a perdu la majeure partie de sa flore gondwanienne tropicale, la sécheresse n’ayant épargné que les plantes les plus résistantes. La savane même, éliminée des provinces de l’Ouest (Kutch et Rajasthan), est restreinte au Centre et à l’Est. La forêt tropicale du centre est repoussée en Assam où s’établit un corridor où passeront les immigrants asiatiques, Mammifères comme le Tigre entre autres. Nous sommes alors au Miocène, et les dernières collisions himalayennes édifient une barrière infranchissable dont la flore moderne de Cèdres et de Genévriers coïncide assez bien avec celle de la bordure méridionale de l’ancienne Téthys, depuis les Atlas marocains.Du côté atlantique, des passages restèrent libres jusqu’à l’Oligocène entre l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale, entre l’Amérique du Sud, l’Antarctide et l’Australie, ainsi que pendant une partie de l’Éocène entre les deux Amériques. La répartition des Mammifères fut influencée par les moindres vicissitudes de cette tectonique globale et complexifiée par la répartition des climats. Les continents gondwaniens, sans l’Afrique ni l’Inde, devinrent peu à peu un monde à part où vécurent des Mammifères plutôt primitifs: Monotrèmes, Marsupiaux, Édentés et descendants des Notungulés de l’Éocène. Des passages entre l’Amérique du Sud et l’Afrique existaient encore, qui permirent aux Singes d’habiter les deux continents. La coupure, à l’Éocène supérieur, de leur dernier lien avec l’Ancien Monde (Eurasie-Afrique) s’est affirmée par la formation d’un détroit au sud de l’emplacement actuel de l’isthme de Panamá, favorisant une évolution originale de toutes sortes d’êtres vivants. L’ensemble Amérique du Sud-Antarctide-Australie demeura jusqu’à l’Oligocène le continent des forêts de Nothofagus (arbre voisin des Hêtres), continent où se développèrent aussi des Oiseaux coureurs.À partir de l’Oligocène, l’isolement complet de tous ces continents était accompli. Il naissait des provinces, dont chacune présente une faune originale, due à une spéciation en anachorèse. De là date la fragmentation que l’on observe de nos jours dans l’habitat de divers animaux, tels les Rhinocéros, les Éléphants et les Marsupiaux. Il n’en fut pas de même pour l’ensemble Amérique du Nord-Ancien Monde qui, bien que coupé au niveau de l’Atlantique Nord par le démantèlement du continent nord-atlantique, resta uni pendant de longues périodes au niveau du détroit de Béring et de celui de Gibraltar. Cependant, à la même époque oligocène, la surrection des chaînes alpines entraînait le cloisonnement de la Téthys, puis sa destruction en tant que grande rocade ayant guidé les migrations d’animaux, surtout marins, pendant plus de 500 millions d’années. De la vieille Téthys-Mésogée restent aujourd’hui la province indo-pacifique et quelques traces autour des Açores, voire des Caraïbes. D’autres provinces marines sont nées et ont acquis leurs faunes particulières.
paléogéographie [ paleoʒeɔgrafi ] n. f.• 1874; de paléo- et géographie♦ Partie de la géographie concernant la description du globe aux temps géologiques. — Adj. PALÉOGÉOGRAPHIQUE .
● paléogéographie nom féminin Géographie des époques anciennes de la Terre.paléogéographien. f. Didac. Description et étude de la Terre (relief, hydrographie, climat, etc.) aux diverses périodes géologiques.⇒PALÉOGÉOGRAPHIE, subst. fém.GÉOGR. Partie de la géographie qui traite des périodes géologiques anciennes et en particulier de la formation des océans et des continents. C'est toute l'histoire des transgressions et des régressions marines, des continents disparus, des surrections de chaînes de montagnes, des grandes fractures, des migrations de faunes marines ou continentales. C'est l'objet de la paléogéographie (FURON ds R. gén. sc., t.63, 1956, p.33).— [Suivi d'un compl. déterminatif indiquant le domaine étudié] Ce sera justement le travail du géologue du XXesiècle d'établir le synchronisme entre les dépôts de même âge (...), de rétablir, grâce à quelques témoins rigoureusement expertisés, la géographie planétaire —la paléogéographie —de chaque ère, de chaque système, de chaque étage (COMBALUZIER, Introd. à la géol., 1961, p.145).Prononc.:[ ]. Étymol. et Hist. 1872 (LITTRÉ Add.). Comp. de paléo- et de géographie.DÉR. Paléogéographique, adj. Qui concerne la paléogéographie ou les instruments qu'elle utilise. Je n'ai pas hésité à introduire, dans l'enseignement élémentaire de la géologie, les cartes paléogéographiques dont on se sert depuis longtemps dans l'enseignement supérieur (BOULE, Conf. géol., 1907, p.6). [Huxley] a montré la différence qu'il y avait entre types primitifs persistants et types spécialisés; il a tenté, à partir des vertébrés, des reconstitutions paléogéographiques (Hist. gén. sc., t.3, vol.1, 1961, p.519). — [
]. Étymol. et Hist. 1872 (LITTRÉ Add.). Comp. de paléo- et de géographie.DÉR. Paléogéographique, adj. Qui concerne la paléogéographie ou les instruments qu'elle utilise. Je n'ai pas hésité à introduire, dans l'enseignement élémentaire de la géologie, les cartes paléogéographiques dont on se sert depuis longtemps dans l'enseignement supérieur (BOULE, Conf. géol., 1907, p.6). [Huxley] a montré la différence qu'il y avait entre types primitifs persistants et types spécialisés; il a tenté, à partir des vertébrés, des reconstitutions paléogéographiques (Hist. gén. sc., t.3, vol.1, 1961, p.519). — [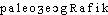 ]. — 1reattest. 1872 (Revue des Deux-Mondes, 15 juill., p.473 ds LITTRÉ Add.); de paléogéographie, suff. -ique.paléogéographie [paleoʒeɔgʀafi] n. f.ÉTYM. 1874; de paléo-, et géographie.❖♦ Didact. Partie de la géographie concernant la description du globe aux temps géologiques.➪ tableau Noms de sciences et d'activités à caractère scientifique.❖DÉR. Paléogéographique.
]. — 1reattest. 1872 (Revue des Deux-Mondes, 15 juill., p.473 ds LITTRÉ Add.); de paléogéographie, suff. -ique.paléogéographie [paleoʒeɔgʀafi] n. f.ÉTYM. 1874; de paléo-, et géographie.❖♦ Didact. Partie de la géographie concernant la description du globe aux temps géologiques.➪ tableau Noms de sciences et d'activités à caractère scientifique.❖DÉR. Paléogéographique.
Encyclopédie Universelle. 2012.
